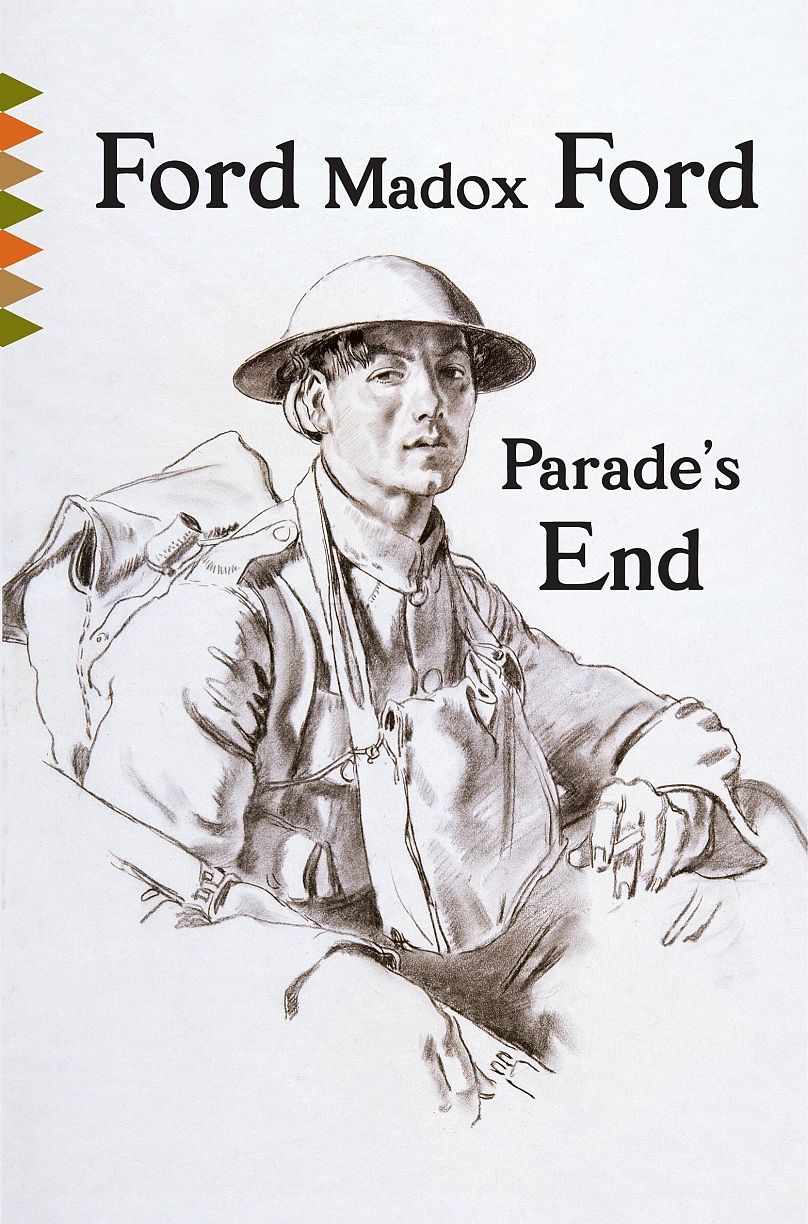Malgré son millésime, la bête de roman déroutante et séduisante de Ford Madox Ford mérite tous les lecteurs qu’elle peut attirer lorsqu’elle aura 100 ans en avril.
Si le centenaire est un anniversaire approprié pour évaluer la pérennité d’un livre, alors il est probablement temps de reconnaître que Graham Greene avait tort.
L’auteur de « Brighton Rock » a commis l’erreur de débutant en essayant de regarder à travers la nuit des temps lorsqu’il a déclaré : « Il n’y a pas de romancier (du 20e siècle) plus susceptible de vivre que Ford Madox Ford. »
Mais si, 100 ans après la publication de son premier volume en avril 1924, vous cherchiez un exemplaire de « Parade’s End » dans votre librairie locale, vous pourriez vous retrouver plus malchanceux que si vous cherchiez, disons, un livre de poche de Greene. « The End of the Affair », ou encore « Brighton Rock », dont la couverture orange emblématique du Pingouin se retrouve désormais imprimée sur des mugs, des tote bag, voire des tabliers.
Greene n’aurait jamais pu prédire quoi que ce soit de tout cela. Les tabliers l’auraient probablement autant énervé que plu. Mais la relative obscurité réservée à Ford Madox Ford aurait été la source d’un désarroi particulier.
Parce que ce n’est pas seulement le travail de Ford qui lui a valu le respect de ses confrères écrivains. Il est également responsable en grande partie de leur succès, ayant fondé deux revues littéraires de premier plan.
Il y publia les travaux d’écrivains modernistes dont DH Lawrence, Ezra Pound, Ernest Hemingway, James Joyce et Jean Rhys, dont beaucoup étaient inconnus avant les encouragements de Ford.
Quant à sa propre carrière d’écrivain, Ford est probablement mieux connu pour « The Good Soldier », publié en 1915. « Parade’s End » arrive juste derrière, mais comparé au mince « The Good Soldier », c’est une perspective plus intimidante pour les lecteurs.
Initialement publié sous forme de quatre livres distincts entre 1924 et 1928, « Parade’s End » retrace l’expérience de guerre de Christopher Tietjens, un membre de la noblesse anglaise aux yeux gris et aux cheveux blonds.
Le roman s’ouvre avant la guerre, avec Tietjens travaillant comme fonctionnaire respecté. Son ex-épouse, Sylvia, est une mondaine promiscuité et à la langue acérée, et les tentatives de Tietjens pour rechercher un rapprochement dans le mariage sont une source récurrente de tension et de désespoir.
Pendant ce temps, Tietjens rencontre une suffragette nommée Valentine Wannop. Il décide bientôt de passer beaucoup plus de temps avec elle.
Lorsque la guerre éclate (et Ford met un point d’honneur à ne jamais décrire la guerre elle-même de manière trop expressive), nous sommes investis non seulement dans le sort de Tietjens, parti se battre, mais aussi dans les fortunes de guerre de Sylvia et Valentin.
Cet étrange triangle amoureux ne procure pas seulement beaucoup d’intérêt pour le personnage ; il éclaire également la période d’immense changement social qui s’ouvre vers la fin de la période édouardienne.
Le plus grand catalyseur du changement est bien entendu la guerre elle-même. Mais avant cela, le mouvement pour le suffrage des femmes dont Valentine est membre a commencé à réellement menacer un certain type de vision du monde masculine dominante.
Ford méprise cette vision du monde dès la première page.
Tietjens et un collègue sont assis dans un wagon bien équipé. « Leur classe administrait le monde », remarque le narrateur. Mais les miroirs à côté desquels ils sont assis « n’avaient que très peu réfléchi ».
Plus tard, en discutant avec Valentine, Tietjens se demande : « Peut-être que l’avenir du monde était alors aux femmes ?
Quant à la valeur de l’ouvrage au-delà de sa perspective thématique ou historique, il faudra suivre l’exemple de Ford. En tant qu’éditeur, il conseillerait : « Ouvrez le livre jusqu’à la page quatre-vingt-dix-neuf et lisez-le, et la qualité de l’ensemble vous sera révélée. »
Mon exemplaire de « Parade’s End » contient un passage à la page 99 décrivant un clerc prenant place à une table de petit-déjeuner. Par souci de concision, voici la phrase la plus courte :
« Il y avait un verre d’eau à côté de son assiette, et autour de lui se fermaient ses longs doigts très blancs. »
Relisez-le.
Bien que modeste au premier abord, la qualité légèrement délicate et fragile de cette description est représentative de l’ensemble. Les phrases de Ford inversent souvent des détails simples : au lieu de décrire, comme on le ferait habituellement, les doigts qui ramassent le verre, il décrit d’abord le verre, puis les doigts.
Lorsqu’elle est utilisée sur des centaines de pages, cette technique maladroite a un effet quelque peu vertigineux. Tous les rythmes et stress habituels d’un roman atterrissent aux mauvais endroits dans « Parade’s End ».
Si cela semble désagréable, c’est parce que c’est censé le faire. Ford écrit sur une époque de l’histoire où tout tombait à contretemps, tout tournait à l’envers.
Semble familier?
Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu, ne vous inquiétez pas. Il existe une excellente adaptation télévisée pour vous aider à démarrer.
En 2012, la BBC a produit une mini-série largement saluée, écrite par Tom Stoppard et mettant en vedette Rebecca Hall dans le rôle de Sylvia et Benedict Cumberbatch dans le rôle de Tietjens. Ce dernier est un casting inspiré pour un personnage qui, en plus d’être charmant, peut aussi être rebutant, flegmatique – étonnamment froid au toucher.
Et si cela ne convient toujours pas, pour ceux qui peuvent le trouver, la BBC a également réalisé une adaptation de 1964 mettant en vedette une jeune Judi Dench dans le rôle de Valentine, ce qui semble être un casting tout aussi inspiré.