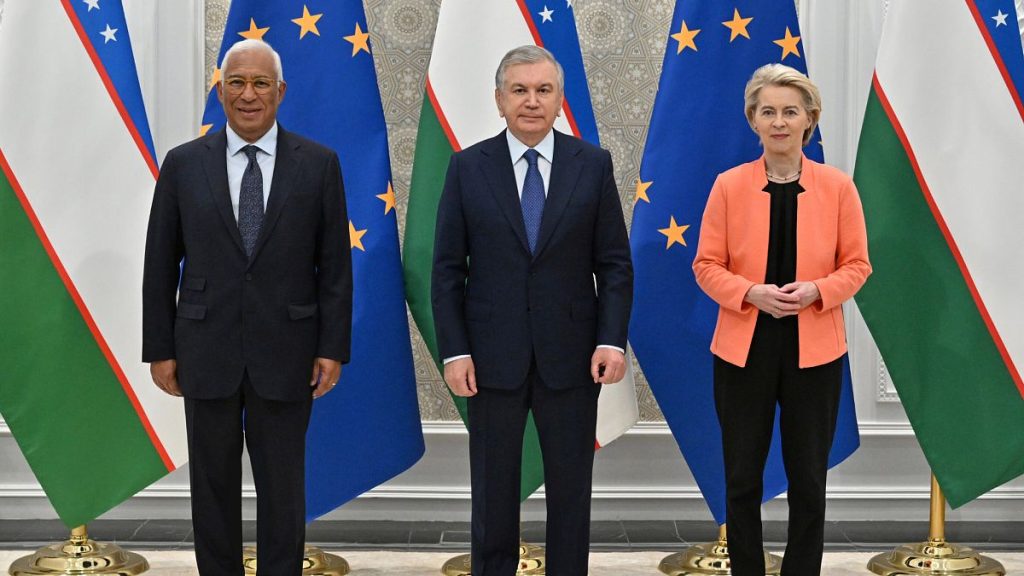Être rémunéré pour « ne rien faire » : une idée absurde en apparence, presque provocatrice face aux injonctions de productivité de nos sociétés modernes. Et pourtant, c’est bien le pari réussi de Shoji Morimoto, un Japonais de 38 ans, qui a bâti une activité rentable et durable en monétisant… sa simple présence.
Dans un pays à la fois technologiquement avancé et socialement exigeant, ce phénomène en dit long sur les besoins émergents de lien, de présence neutre et de disponibilité sans attentes. Loin d’un caprice individuel, le cas Morimoto soulève des questions de fond sur l’évolution du travail, la solitude urbaine et la valeur de la présence humaine.
L’homme qui « ne fait rien », mais qui est là
Ancien salarié dans l’édition, Shoji Morimoto a quitté son poste après avoir été critiqué pour son inactivité perçue au sein de son entreprise. Ce reproche s’est transformé en levier de réflexion : et si cette capacité à « ne rien faire » pouvait devenir un service ?
C’est ainsi qu’il a lancé une activité atypique : proposer sa présence, sans interaction imposée, sans prestation spécifique. Il facture l’équivalent de 71 euros de l’heure (10 000 yens), et cumule depuis quatre ans près de 4 000 prestations. Avant la pandémie, ses revenus avoisinaient 300 euros par jour, de quoi subvenir aux besoins de sa famille.

Mais que fait-il concrètement ? La réponse est dans la nuance : il accompagne sans intervenir, présente sans juger, existe sans envahir. Il a ainsi été sollicité pour :
- dire au revoir à un voyageur solitaire à l’aéroport,
- partager une balançoire dans un parc,
- accompagner une femme portant un sari qui craignait le regard des autres.
Des tâches simples, mais symboliquement fortes. « Avec lui, je n’ai pas besoin de parler ni de me forcer à interagir », explique une de ses clientes, analyste de données. La neutralité émotionnelle qu’offre Morimoto agit comme un soulagement dans un monde saturé d’attentes relationnelles.

Un business révélateur d’un besoin social profond
Au-delà de la singularité de l’activité, ce modèle économique repose sur une demande croissante : le besoin de lien sans engagement, dans un contexte de solitude croissante. Au Japon, comme dans d’autres pays industrialisés, le vieillissement de la population, l’urbanisation, et la pression sociale contribuent à un isolement structurel, souvent invisible mais pesant.
Le service proposé par Morimoto fonctionne précisément parce qu’il n’impose aucune performance sociale : pas de conseil, pas d’avis, pas de jugement. Il agit comme un miroir neutre, un compagnon silencieux. Un rôle qui rappelle parfois celui d’un thérapeute, mais sans en revendiquer les codes.
Une activité encadrée, mais lucrative
Morimoto a fait de cette présence passive sa source principale de revenus. Il a refusé plusieurs sollicitations qu’il jugeait incompatibles avec son éthique : déménagement d’un réfrigérateur, voyage à l’étranger, ou services à connotation sexuelle. Sa ligne de conduite est claire : offrir sa présence, mais pas son corps ni ses compétences physiques.
Ce modèle, aussi atypique soit-il, rencontre un succès croissant au Japon, et suscite une curiosité internationale. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de dématérialisation du travail, où la valeur n’est plus forcément liée à une production tangible, mais à l’attention, au soutien discret, voire à la simple disponibilité.

Une nouvelle frontière du travail ?
La réussite de Shoji Morimoto nous oblige à questionner certaines certitudes. Dans un monde où l’utilité est souvent mesurée en productivité, son exemple illustre une autre forme de service, non-marchand en apparence, mais profondément humain.
Son activité met en lumière une forme d’économie de la présence, de plus en plus nécessaire dans nos sociétés numériques, où la connexion technique remplace parfois la connexion émotionnelle. Ce qui est monétisé ici, ce n’est pas l’action, mais la capacité à être là sans interférer. Une posture rare, mais de plus en plus précieuse.
En définitive, Shoji Morimoto ne fait peut-être « rien », mais il remplit un vide bien réel, celui d’une solitude moderne qui touche même les environnements les plus connectés. Ce cas, bien plus qu’une curiosité japonaise, ouvre un débat profond : à l’avenir, quelle place donnerons-nous à l’invisible, au silence, à la présence brute dans nos économies ?